 |
 |
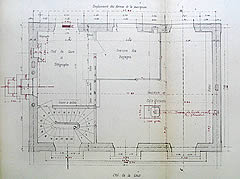 |
 ZOOM
ZOOM
Stations de chemin de fer
« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.
Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.
Bâtiment des voyageurs.
A Marmande, le 31 mars 1884. |
 |
 |
 |
 |
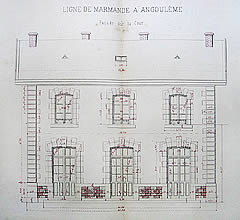 |
 ZOOM
ZOOM
Stations de chemin de fer
« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.
Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.
Bâtiment des voyageurs.
A Marmande, le 31 mars 1884.
Plan 1 Façade sur la cour. »
Source : Archives Départementales de Lot-et-Garonne
Projet d’un modèle type qui s’applique dans différents
sites. |
 |
 |
 |
 |
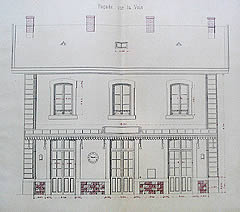 |
 ZOOM
ZOOM
Stations de chemin de fer
« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.
Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.
Bâtiment des voyageurs.
A Marmande, le 31 mars 1884.
Plan 2
Façade sur la voie. »
Source : Archives Départementales de Lot-et-Garonne |
 |
 |
 |
 |
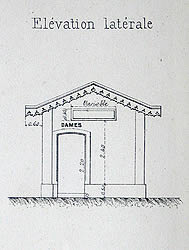 |
 ZOOM
ZOOM
Stations de chemin de fer
« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.
Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.
Bâtiment des voyageurs.
A Marmande, le 31 mars 1884.
Plan 4 Cabinets
Elévation latérale. »
Source : Archives Départementales de Lot-et-Garonne |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Seyches ; 1884 ; Ingénieur en
chef : M. Pasqueau ; façade arrière (vue sur la voie). Gare
aujourd’hui reconvertie en école. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Seyches ; 1884 ; Ingénieur en
chef : M. Pasqueau ; façade principale (vue sur la cour). Gare aujourd’hui
reconvertie en école. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°
siècle ; maître d’œuvre inconnu ; bâtiment de la gare
vue de loin. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°
siècle ; maître d’œuvre inconnu ; détails : baies
en arc cintré, modillons, fronton et toiture. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°
siècle ; maître d’œuvre inconnu ; vue sur une partie de
la halle (ossature métallique soutenue par ses colonnes). |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°
siècle ; maître d’œuvre inconnu ; détails de la structure
métallique et de la verrière. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare d’Aiguillon ; 1850 environ ; architectes
: Léopold Payen et Gustave Bourières ; vue d’ensemble de la
gare d’Aiguillon. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare d’Aiguillon ; 1850 environ ; architectes
: Léopold Payen et Gustave Bourières ; détails de la façade,
du toit, des encadrements d’ouvertures et d’un chaînage d’angle. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Monsempron-Libos ; 1862 ; maître
d’œuvre inconnu ; vue sur la façade principale de la gare. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare de Monsempron-Libos ; 1862 ; maître
d’œuvre inconnu ; vue sur la halle située sur le quai de la gare
: colonnes en fonte et ossature métallique soutenant la toiture. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare d’Agen ; 1856 ; maître d’œuvre
inconnu ; détails de 4 baies en arc cintré et du fronton avec son
horloge. |
 |
 |
 |
 |
 |
 ZOOM
ZOOM
Gare d’Agen ; 1856 ; maître d’œuvre
inconnu ; vue d’ensemble de la gare d’Agen. |
 |
 |
|
Gares
L'importance du chemin de fer dans la révolution industrielle donne
aux gares un statut architectural particulier : c'est l'image la plus représentée
et la plus étonnante des nouveaux programmes et des nouvelles techniques qui
se mettent alors en place.
La typologie des premiers bâtiments de gare s'articule
autour de deux axes, sur lesquels ingénieurs et architectes planchent :
- un bâtiment traditionnel abritant la billetterie, les salles d'attente et le
service des bagages,
- une halle suffisamment vaste afin que les vapeurs des locomotives s'atténuent
autant que possible.
Cependant, cette typologie ne cessera d'évoluer au cours du XIXème siècle,
face à la multiplication des services offerts aux voyageurs : salle d'attente
pour les 3 classes, messagerie, vestibule, boutiques, restaurant, hôtel...
Le style renaissance a été adopté par un
grand nombre de gares notamment dans les modestes gares de campagne, avec toujours
une composition symétrique. Cela a permis d'intégrer l'architecture
ferroviaire à presque toutes les configurations urbaines, en lui conservant
une certaine identité.
L'architecture des bâtiments de gare se distingue généralement
selon l'importance du trafic.
Les gares de 1ère classe, réservées aux grandes villes font l'objet
d'un projet spécifique : le bâtiment « voyageurs » est composé
d'un pavillon central doté d'ailes d'importance variable.
Dans les gares les plus modestes, les ailes sont inexistantes et tous les services
sont regroupés dans un espace unique.
Les plans types sont souvent dressés par des ingénieurs pour des besoins
locaux, seuls les matériaux de façades peuvent varier. Les maisons des
gardes-barrières sont elles aussi construites selon un même modèle.
De nombreuses stations de type 3ème classe ont été construites
dans la campagne du département. Etant adaptées à la fréquentation
des voyageurs, c'est un bâtiment de petite taille. Le programme de base comprend
le hall des billets, le service des bagages, les salles d'attente et le logement du
chef de gare.
Gare d'Agen
Pour la construire, le cimetière Sainte Foy est déménagé
à Gaillard. Figurant parmi les gares de 1ère classe, elle a bénéficié
d'un projet architectural spécifique. Sa façade est longue de 100 mètres.
Elle est percée par 23 baies en arc cintré, dont 5 sises dans l'avant-corps
central, sont ouvertes sur le vestibule. Cela confère à l'édifice
un caractère monumental. Deux ailes latérales sont ajoutées en
1886 (elles seront détruites en 1981 lors de travaux de rénovation).
|